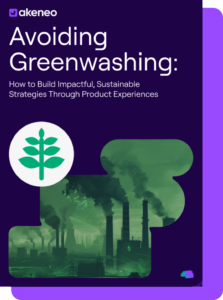Rester à jour face à l’évolution rapide des réglementations durables peut sembler complexe. Pourtant, c’est une véritable opportunité pour les entreprises de renforcer leur transparence, leur responsabilité et leur capacité à innover. En adoptant une démarche proactive, il est possible non seulement de répondre aux nouvelles exigences, mais aussi de gagner en efficacité et en compétitivité. Cet article vous guide à travers les étapes clés pour structurer vos données, mobiliser les bons outils et anticiper les prochaines obligations réglementaires.

Sommaire
Mots-clés
Les entreprises font face à une intensification rapide des réglementations en matière de durabilité, émanant d’organismes nationaux et internationaux. Anticiper ces exigences devient indispensable pour éviter les erreurs coûteuses, les sanctions ou les blocages commerciaux. Pourtant, la tâche reste complexe : les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ont augmenté de 155% en dix ans, et leur périmètre ne cesse de s’étendre. Dans ce contexte, adopter une approche proactive permet non seulement de sécuriser la conformité, mais aussi de structurer ses données, de mobiliser les bons outils, et de transformer cette contrainte en véritable avantage concurrentiel.
Pendant des années, les entreprises ont pu opérer sans réelle obligation de rendre compte de leur impact environnemental. Résultat : des pratiques trompeuses sur la durabilité (connues sous le nom de greenwashing) se sont largement répandues. Une étude menée en 2022 a révélé que 58% des dirigeants interrogés (PDG et membres de comités exécutifs) admettaient que leur entreprise y avait eu recours.
Pourquoi une telle situation ? Le manque de contrôle et de sanctions en est l’une des principales causes. Aux États-Unis, par exemple, la Federal Trade Commission (FTC) n’a engagé qu’une centaine de poursuites pour greenwashing en trente ans.
En outre, les effets réels sur l’environnement posent problème. L’industrie mondiale de la mode génère à elle seule 10% des émissions de CO₂, et les expéditions et retours de produits représentent 37% des émissions du secteur logistique.
Ce modèle n’est plus pérenne. Les consommateurs exigent plus de transparence, et les pouvoirs publics imposent des règles plus strictes. Les entreprises doivent désormais démontrer, preuves à l’appui, l’impact réel de leurs produits et de leur chaîne de valeur. Les réglementations deviennent ainsi un levier d’action structurant pour une transition durable crédible.
Les réglementations en matière de durabilité se multiplient à l’échelle mondiale. Leur périmètre évolue rapidement et concerne désormais un nombre croissant d’entreprises. Voici deux initiatives majeures déjà en vigueur ou en cours de déploiement.
Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la directive européenne sur le reporting de durabilité Adoptée dans le cadre du Pacte vert européen, la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD) renforce considérablement les exigences de transparence imposées aux entreprises.
Elle succède à la directive NFRD (Non-Financial Reporting Directive) et impose désormais la publication de données détaillées sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces rapports doivent suivre les normes européennes ESRS (European Sustainability Reporting Standards) et faire l’objet d’un audit indépendant.
À partir de 2025, la CSRD s’appliquera progressivement à :
Cette directive marque une évolution majeure : la durabilité ne relève plus uniquement de la communication RSE, mais devient un exercice normé, vérifié et intégré au pilotage de l’entreprise.
Autre mesure phare du Pacte vert européen, les Passeports Numériques des Produits, ou Digital Product Passports (DPP), visent à renforcer la transparence tout au long du cycle de vie des produits. Ils imposeront aux entreprises de fournir un accès numérique, le plus souvent via un QR code, à des informations détaillées sur chaque produit : composition, origine, méthode de fabrication, impact environnemental ou encore recyclabilité. Ces données devront être disponibles depuis la phase de production jusqu’à la fin de vie du produit. L’objectif est de responsabiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, y compris les consommateurs, en facilitant le tri, la réparation, le réemploi ou le recyclage. Plusieurs secteurs seront concernés en priorité, notamment l’électronique, le textile, le mobilier et les équipements industriels.
Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) s’applique spécifiquement au secteur financier. Il a pour objectif de renforcer la transparence sur la manière dont les acteurs financiers intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs pratiques d’investissement. Ce texte vise également à limiter les pratiques de greenwashing et à orienter les flux de capitaux vers des produits réellement durables.
Le SFDR impose aux gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance, fonds de pension et conseillers en investissement opérant dans l’Union européenne de publier des informations précises sur leur approche en matière de durabilité. Ces obligations s’appliquent à deux niveaux : au niveau de l’entité (stratégies globales en matière de risques ESG) et au niveau des produits financiers (degré de prise en compte des objectifs de durabilité). Le règlement introduit aussi un système de classification des produits en fonction de leur niveau d'engagement ESG, et impose la publication d’indicateurs clés tels que les principaux impacts négatifs des investissements sur l’environnement ou la société.
Entré en vigueur par étapes depuis mars 2021, avec un renforcement des exigences en 2022, le SFDR contribue à structurer le reporting ESG dans le secteur financier. Il permet aux investisseurs d’évaluer plus objectivement la durabilité réelle des produits proposés, tout en alignant progressivement les pratiques du marché avec les objectifs environnementaux et sociaux définis par l’Union européenne.
La taxonomie européenne (EU Taxonomy) est un système de classification qui définit les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte vert aux côtés de la CSRD et de la SFDR, et vise à orienter les investissements vers des activités alignées avec les objectifs environnementaux de l’Union européenne. Ces objectifs incluent l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la préservation de l’eau et des ressources marines, l’économie circulaire, la prévention de la pollution et la protection de la biodiversité.
Fondée sur des critères techniques stricts, la taxonomie impose aux entreprises de démontrer qu’une activité contribue significativement à l’un de ces objectifs sans porter atteinte aux autres. Les premiers critères, relatifs au climat, sont entrés en vigueur en 2022. Ceux concernant les autres domaines sont en cours de finalisation, avec une application complète prévue d’ici fin 2025. Ce cadre vise à renforcer la transparence et à crédibiliser les engagements environnementaux dans les rapports financiers et extra-financiers.
Pour répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité, les entreprises doivent structurer leur démarche autour de cinq piliers clés, combinant rigueur opérationnelle et choix technologiques adaptés.
La conformité repose d’abord sur une collecte précise des données, couvrant l’ensemble du cycle de vie du produit : matières premières, chaîne d’approvisionnement, fabrication, distribution et fin de vie. Ces informations doivent être fiables, traçables et facilement mobilisables pour alimenter les futurs rapports réglementaires.
L’utilisation d’une solution de Product Information Management (PIM) permet de centraliser les données, d’en garantir la cohérence, et de les enrichir avec des attributs liés à la durabilité (recyclabilité, origine, labels, etc.). Cette structuration facilite leur réutilisation à travers les différents canaux (étiquetage, marketplaces, rapports ESG, etc.).
ALes outils d’intégration des données fournisseurs facilitent la collecte d’informations sur les pratiques de durabilité des partenaires commerciaux.
L’IA (intelligence artificielle) peut accélérer la mise en conformité en automatisant la catégorisation, en repérant les données manquantes, ou en proposant des enrichissements cohérents. Elle permet aussi d’identifier les écarts ou les incohérences dans de larges volumes de données. Toutefois, elle doit s’intégrer dans un processus supervisé par les équipes métier.
Des systèmes connectés évitent les silos et permettent une collaboration efficace au sein des organisations.
Pour les entreprises qui font le choix d’anticiper, la conformité ne se limite plus à une obligation réglementaire. Elle devient un accélérateur d’innovation, de rigueur opérationnelle et de confiance auprès des clients comme des partenaires. En investissant dès aujourd’hui dans les bons outils et processus (de la structuration des données à la collaboration fournisseurs) les marques se donnent les moyens de répondre aux exigences de demain tout en se positionnant en acteurs responsables, transparents et compétitifs.
Discover how to avoid the pitfalls of greenwashing and build genuinely sustainable strategies that foster trust, align with regulations, and drive long-term business growth.